La Langue Kurde
Avec 40 à 45 millions de locuteurs, la langue kurde est la quatrième langue la plus parlée au Moyen-Orient après l’arabe, le turc et le persan. La langue est un élément essentiel de l’identité des kurdes en tant que peuple. Pourtant cette langue n’est pas unifiée et n’a jamais été standardisée. Le kurde compte en effet de nombreux dialectes, assez éloignés les uns des autres pour certains.
Le
kurde est une langue appartenant à la famille des langues indo-européennes et
plus précisément à la branche indo-iranienne de cette famille. Il est parlé par
les kurdes, qui peuplent une vaste région appelée le Kurdistan, qui se répartit
aujourd’hui entre quatre Etats : le Sud-Est de la Turquie, le Nord-Ouest de
l’Iran, le Nord de l’Irak et le nord de la Syrie.
Il existe également des îlots de peuplement kurdes dans
d’autres pays, du fait de déplacements et de déportations au cours de
l’Histoire. Ainsi, on trouve des communautés kurdes et kurdophones dans les
pays du Caucase, les pays d’Asie centrale, en Russie, au Liban et en Israël. Quelques
millions de kurdes ont également fuit leur pays au cours des dernières
décennies et constituent des diasporas plus ou moins importantes dans
différents occidentaux.
Nous allons dans un premier temps nous intéresser à la
répartition géographique des différents dialectes du kurde ainsi qu’à leurs
origines, avant de voir si les locuteurs de ces dialectes peuvent se comprendre
et enfin nous allons analyser les politiques de défense, de développement et de
standardisation du kurde.
La répartition des dialectes kurdes et leurs origines
Le
kurde est divisé en quatre dialectes que sont le Kurmandji et le Sorani qui
sont les plus apparentés, le Gorani (y compris Laki et Hewrami) et le Dimili
(ou Zazaki). Le Gorani et le Dimili partagent des particularités et des
caractéristiques communes comme cela a été révélé par des chercheurs, malgré le
fait que les locuteurs de ces deux dialectes soient les plus éloignés
géographiquement parmi les kurdes.
Le Kurmandji est le
seul dialecte parlé dans les quatre parties du Kurdistan, puisqu’on le retrouve
dans le Sud et l’Est de la Turquie, dans le Nord de la Syrie, dans le
Nord-Ouest de l’Iran et dans le Nord de l’Irak, plus précisément dans la partie
nord de la Région Autonome du Kurdistan, ainsi que dans les grandes métropoles
de Turquie telles que Istanbul où on estime à 3 millions le nombres de kurdes.
Le Sorani est parlé dans le Sud de la Région Autonome du Kurdistan d’Irak ainsi
que dans l’Ouest de l’Iran. Le Gorani est parlé dans le Sud des régions kurdes
d’Iran et dans une moindre mesure d’Irak, et le Dimili est parlé dans le Nord
des régions kurdes de Turquie.
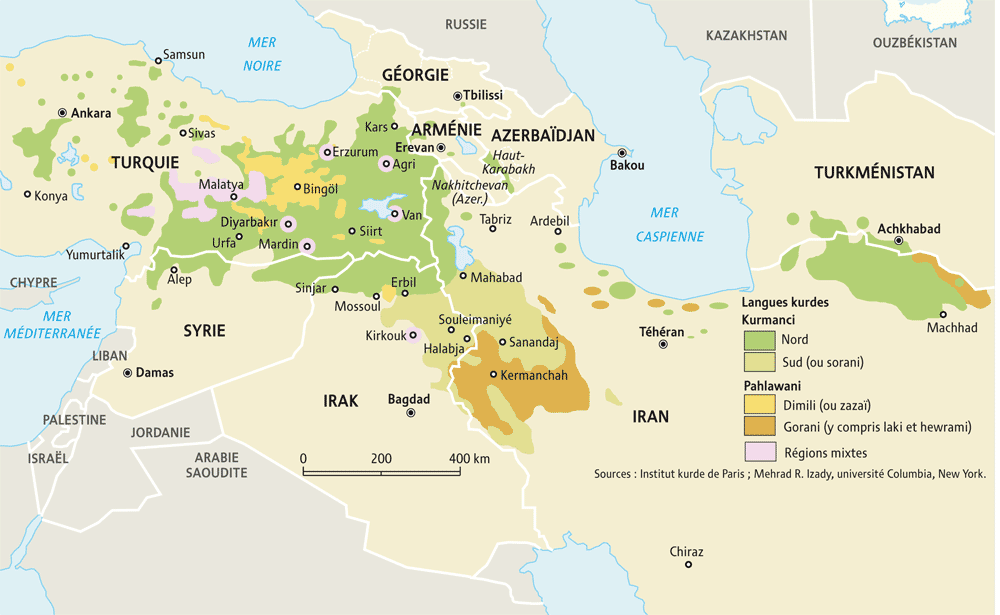
Carte des zones de répartition des différents dialectes kurdes. Source: Institut Kurde de Paris
Il faut savoir que ces deux derniers dialectes sont considérés comme des variétés en danger par l’Unesco parce qu’ils comptent peu de locuteurs et de transmission intergénérationnelle.
L’existence de
ces différents dialectes s’explique par des raisons à la fois géographiques,
historiques, politiques et linguistiques.
En effet la langue varie naturellement dans l’espace, en société et à
travers le temps. La variation est un facteur constitutif des langues.
Cela est d’autant plus déterminant pour ce qui est de la géographie du
Kurdistan, dont le relief montagneux a toujours rendu difficile les échanges et
les communications. Donc les régions ont développé et gardé des particularités
spécifiques. Enfin,
l’unification des langues relève toujours de décisions politiques, de
construction des Etats-nations notamment. Les Kurdes n’ont pas eu la
possibilité de fonder un Etat et de faire émerger une langue commune, les
dialectes se sont donc conservés.
Sans unification, chaque dialecte s’est
aussi un peu développé sous la contrainte des langues officielles des Etats
modernes issus de la Première Guerre Mondiale, dans lesquels vivaient ses
locuteurs. Par exemple le Sorani a beaucoup emprunté de mots à l’arabe ou au
persan, alors que les kurdes de Turquie (Kurmandji) ont sur le plan lexical
emprunté des mots au turc.
Il existe également des différences
grammaticales entre les différents dialectes kurdes. Par exemple le Kurmandji conserve le genre grammatical
(masculin-féminin) alors que le Sorani ne l’a pas. Le Dimili lui aussi conserve
le genre grammatical qui se manifeste même dans les pronoms personnels. Le
Kurmandji a deux types de pronoms, le nominatif et le cas oblique, alors que le
Sorani a réduit cela à un seul groupe. Il y a également des différences
phonologiques entre les dialectes.
Mais avec toutes ces différences, les
locuteurs de ces dialectes peuvent-ils se comprendre entre eux ?
L’intercompréhension
entre les différents dialectes
Il y a encore 30 ou 40 ans,
l’intercompréhension était très réduite et elle dépend encore aujourd’hui de la
distance géographique. Plus les locuteurs des différents dialectes vivent dans
des régions proches plus ils auront de chances de se comprendre.
Avec le développement des télévisions
par satellite et des médias en ligne plus tard, les quatre dialectes, mais
surtout le Kurmandji et le Sorani, se diffusent largement. Les télévisions, de
la Région du Kurdistan d’Irak notamment ont fait beaucoup d’efforts dans ce
domaine. Elles ont popularisé les différentes variétés du kurde, et familiarisé
les locuteurs aux différences lexicales et grammaticales.
En outre, les kurdes ont désormais
beaucoup plus de possibilités de se rencontrer, que ce soit au Kurdistan ou en
diaspora. Il y a aujourd’hui une mobilité des personnes qui n’existait pas du
tout, ou très peu, autrefois.
Défense,
développement et standardisation du kurde
La défense, la diffusion ou les efforts
de standardisation du kurde varient selon les époques et les Etats dans
lesquels vivent aujourd’hui les kurdes (Irak, Iran, Syrie et Turquie).
En Irak, malgré la répression féroce
qu’ont subit les Kurdes, leur langue n’a jamais été interdite officiellement.
Donc l’enseignement, la standardisation ou encore la littérature, ont toujours
plus ou moins été possible. Bien entendu,
les Kurdes ont fait face à de nombreuses discriminations et répressions en
raison de l’utilisation de leur langue, en particulier sous le régime baasiste où
de nombreux Kurdes ont été arrêtés et même exécutés pour avoir écouté des
chansons kurdes par exemple.
En Turquie, le kurde
a été interdit, y compris en privé et au sein des familles, dès la création de
la République turque en 1923, et tous les travaux sur la langue kurde ont été
assimilés à du terrorisme. Il y a donc eu un développement de groupes de
travail en diaspora. On peut par exemple citer le Séminaire Kurmandji ou le
groupe « Vaté » pour le Zazaki (Dimili), qui ont documenté la langue,
archiver des chansons, des histoires et travaillé à la normalisation de
l’orthographe.
Il faut noter
qu’aujourd’hui des acteurs ou des militants sociaux se servent des ressources
linguistiques des différents dialectes pour répondre à des besoins spécifiques
pour ce qui est des termes nouveaux, des néologies de vocabulaire. L’Institut Kurde de Paris a par exemple crée
un dictionnaire franco-kurde avec 85 000 mots des quatre dialectes.
Depuis quelques années, le kurde n’est plus formellement interdit en Turquie et a même été mis dans le système éducatif, mais en optionnel. Mais dans la pratique cela est très inégalitaire. Par exemple la Turquie envoie chaque année près de 1 500 professeurs en Europe pour enseigner le turc aux immigrés et à la diaspora turque, alors que pour les millions de Kurdes vivants en Turquie, seulement quelques dizaines de professeurs sont recrutés par l’Education Nationale turque, et ce malgré les très nombreuses demandes et revendications des familles pour l’enseignement du kurde.
Avec toutes les
destructions qu’a connu le Kurdistan à travers l’Histoire, beaucoup de sources
écrites ont disparu. Malgré cela des œuvres littéraires kurdes du 16éme siècle
notamment, ont pu être conservées, telles que celles des écrivains Ali Hariri,
Malaye Jaziri, Faqi Tayran ou encore Ahmad Khani.
Le véritable
développement d’une littérature en langue kurde remonte à l’époque de la
Première Guerre Mondiale. Les Kurdes se rendant compte qu’ils ont perdu sur le
terrain militaire et politique, tentent de sauver ce qui peut l’être, la langue
et la littérature qui serviront à dénoncer leur condition.
La langue kurde, malgré sa diversité, est donc
profondément unie et représente un élément essentiel de l’identité de ce peuple
qui est par ailleurs divisé sur le plan politique, historiquement réparti en
principautés ou seigneuries rivales sous domination de différents empires, et dont
le territoire est désormais divisé entre quatre Etats.
La défense
de leur langue est perçue par les kurdes comme un enjeu existentiel pour leur
survie en tant que peuple.
Sincères remerciements
au professeur Salih Akin de l’Université de Rouen pour son aide précieuse à la rédaction
de cet article.
Remerciements
particuliers à l’écrivain Kurde Farzin Karim.
